Figure 1. Exemple d'univers virtuel contenant 4
Locales. Chaque Locale représente un système
de coordonnées locales décalée d'une translation par rapport au système
de coordonnées global.
Java3D est une bibliothèque logicielle de haut niveau facilitant la création, la visualisation et la manipulation de scènes 3D. Java3D fournit une API en java et bénéficie donc de la portabilité de ce langage. Java3D est porté sur différentes plateformes. Il utilise (de manière transparente pour l'utilisateur) des bibliothèques graphiques de plus bas niveau telles qu'OpenGL ou DirectX pour réaliser le rendu 3D.
Java3D n'est pas un modeleur (tel que 3D studio): il n'offre aucun support pour l'édition d'objet et de scènes 3D. Il permet en revanche de programmer son propre modeleur à moindre coût. Java3D n'est pas non plus un format de données 3D (tel que VRML): certaines fonctions d'importation/exportation vers différents formats standards existent mais Java3D ne défini pas en soi de format particulier.
Le principales fonctionnalités de Java3D sont:
L'utilisation de Java3D nécessite que les packages
javax.media.j3d, javax.vecmath, et
com.sun.j3d.utils soient installés sur votre système. Ces
classes sont disponibles sous formes d'archives:
j3dcore.jar, j3daudio.jar,
j3dutils.jar et vecmath.jar.
Nous utiliseront une implémentation spéciale de java installée dans
/net/opt/blackdown-jdk-1.4.2.0 qui supporte une version 1.3.1 de l'API
java3D. L'API elle même est installée dans
/net/opt/blackdown-java3d-bin. Pour le bon fonctionnement de java 3D
vous devrez:
export
CLASSPATH=/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/j3dcore.jar:/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/j3daudio.jar:/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/j3dutils.jar:/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib/vecmath.jar:.:${CLASSPATH}
alias java='java -Djava.library.path=/net/opt/blackdown-java3d-bin/lib'
Dans vos fichiers java, vous devrez importer les packages:
import javax.media.j3d.*; import javax.vecmath.*; import com.sun.j3d.utils.universe.*;La compilation et l'exécution se font ensuite de manière standard:
javac *.java java MaClassePrincipale
Un programme Java3D décrit un univers virtuel qu'il est
possible de visualiser et dans lequel on peut naviguer. La structure
fondamentale de java3D est la classe VirtualUniverse
contenant à la fois la description du contenu de la scène 3D à
visualiser et les informations de visualisation. Dans un premier temps
nous utiliserons une classe dérivée simplifiée nommée
SimpleUniverse.
L'univers virtuel de Java3D est construit de telle sorte qu'il
permette la représentation de l'univers physique connu: il utilise un
système de coordonnées de haute précision vous permettant de
représenter 2 noyaux atomiques situés aux confins de l'univers si vous
le désirez. Afin d'obtenir une telle précision, les nombres flotants à
double précision classiques (encodés sur 64 bits) ne sont pas
suffisants. Java3D définit des flotants à haute précision (classe
HiResCoord) encodés sur 256 bits. Un objet de
localisation (classe Locale) définit une origine locale
dans l'univers virtuel à partir d'une translation haute précision.
Localement, autour de l'origine définie par un Locale,
les coordonnées en double précision classiques sont suffisante pour
représenter tous types d'objet. La figure 1 représente un univers
virtuel dans lequel ont été ajouté 4 Locales
différentes. Dans l'exemple ci-dessus, les deux atomes
appartiendraient à deux Locales différents dont les
origines sont positionnées aux confins de l'univers virtuel mais leur
position et leur géométrie pourrait être représentée localement avec
des nombres en double précision. La grande majorité des programmes
Java3D n'utilise qu'un objet de type Locale dans lequel
sont représentés tous les objets de l'univers virtuel mais dans
certains cas il peut devenir nécessaire de faire appel à plusieurs
Locales.
Locales. Chaque Locale représente un système
de coordonnées locales décalée d'une translation par rapport au système
de coordonnées global.
Dans chaque Locale, les objets 3D composant la scène
manipulée sont représentés dans un graphe de scène. Un graphe de
scène est un graphe direct acyclique dont la racine est l'univers
virtuel et composé de noeuds représentant des transformations 3D ou
des groupes d'objets graphiques. Aux feuilles de ce graphes sont
décrit les objets graphiques. Un graphe de scène étant acyclique et
direct (orienté dans un seul sens), il existe un seul chemin de la
racine vers chaque feuille. Le parcours de ce chemin déterminera
comment l'objet graphique de chaque feuille sera représenté (après
possibles transformations géométriques ou étapes de contrôle du
rendu). La figure 2 représente un graphe de scène minimal. Dans
l'univers virtuel, un seul système de coordonnées locales a été
défini. A cette origine est attachée une branche (classe
BranchGroup). Il pourrait y avoir différentes branches
décrivant différentes sous-parties du graphe de scène. La branche
contient une noeud de transformation géométrique (classe
TransformationGroup). Sous le noeud de transformation se
trouve une feuille du graphe: un objet graphique. Lors de la
visualisation de cette scène, la géométrie de l'objet graphique sera
conditionnée par les noeuds rencontrées lors du parcours de la branche
menant à cette feuille: ses coordonnées seront translatées selon le
systèmes de coordonnées locales puis transformées par la
transformation 3D de l'avant dernier noeud.
Le graphe de scène permet de décrire une scène 3D, de la plus simple (telle que celle représentée dans la figure 2) à la plus complexe (en garnissant le graphe de scène de branches multiples). Il manque encore un élément essentiel à la réalisation de tout programme Java3D: la visualisation. La visualisation est composée de deux éléments:
ViewPlatform) qui définit l'angle
sous lequel est vue la scène 3D;
Viewer et
Canvas3D).
Le point de vue est considéré comme une feuille du graphe de scène: il se trouve au bout d'une branche classique du graphe. L'interface de visualisation est composée d'objets n'appartenant pas vraiment au graphe de scène mais faisant la liason entre la feuille "point de vue" et la fenêtre de visualisation. La figure 3 illustre un graphe de scène complet incluant une branche de visualisation.
Le point de vue (ViewPlatform) est en bout d'une branche
du graphe de scène. Le noeud juste au dessus est une transformation 3D
définissant sa position. L'objet ViewPlatform dispose
d'une référence sur un objet de type
View. View est la classe centrale de la
chaîne de visualisation. Elle établit un lien entre le graphe de scène
(en référençant l'objet ViewPlatform), la fenêtre de
visualisation (de type Canvas3D, héritant de
java.awt.Canvas) et la représentation virtuelle de l'oeil
regardant la scène et de son environnement (classes
PhysicalBody et PhysicalEnvironement).
La création d'un graphe de scène et d'une chaîne de visualisation
complète offrent une grande liberté mais sont aussi assez fastidieuses
en raison du nombre d'objets manipulés. La majorité des applications
simples ne nécessitent pas toute la souplesse que peut offrir Java3D
et peuvent se contenter d'une version simplifiée de l'univers virtuel
et des classes qui lui sont rattachées. A cet effet, la classe
SimpleUniverse, dérivée de VirtualUniverse,
a été écrite dans le package com.sun.j3d.utils. Un
univers simple englobe toute la branche de visualisation du graphe de
scène et la chaîne de visualisation associée comme illustré dans la
figure 3.
TD1: un univers simple
Dans les étapes suivantes, vous allez écrire votre premier programme Java3D: vous ferez afficher un cube tournant aux facettes colorées tel que représenté dans la figure 4 ci-dessous:
SimpleUniverse. Créez une branche du graphe de
scène dans lequel vous pourrez attacher le cube. La méthode void
SimpleUniverse.addBranchGraph(BranchGroup) vous permettra de
connecter la branche à votre univers. L'objet cube coloré est
disponible dans la classe
com.sun.j3d.utils.geometry.ColorCube. Chaque groupe
(i.e. chaque noeud qui n'est pas une feuille) du graphe de
scène dispose d'une méthode addChild permettant d'ajouter
un fils au groupe concerné. Une fois le graphe de scène complet, vous
devrez définir la position du point de vue de façon à se que l'oeil
virtuel regarde la scène depuis un point extérieur. Vous ferez appel
pour cela à la commande:
mySimpleUniverse.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform().
Vous pourrez enfin créer une Frame de l'AWT java dans
laquelle vous ajouterez une fenêtre de type Canvas3D. Le
constructeur de Canvas3D nécessite un objet de
configuration de type
java.awt.GraphicsConfiguration. Vous pouvez créer un
objet de configuration standard par appel à la commande:
SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(). Votre
premier programme est complet: vous devez être à même de visualiser le
cube. Comme celui-ci est vu de face, un seul carré (rouge) apparaît à
l'écran.
TransformGroup entre la racine de la branche et le
cube. Le constructeur de TransformGroup prend en
paramètre une transformation 3D (composition d'une translation, d'une
rotation et d'un facteur d'échelle) de type
Transform3D. Faîtes appel aux méthodes rotX,
rotY, rotZ et mul de
Transform3D pour composer des rotations selon les axes X,
Y, et Z. Modifiez votre programme pour prendre 3 angles sur la ligne
de commande et utiliser ces angles dans la composition de la
transformation. Vérifiez que la visualisation du cube est bien celle
que vous attendez sous différents angles. Déterminez la direction des
axes dans le repère par défaut de Java3D. Identifiez quelle face
(couleur) correspond à quelle direction.
GraphBranch.compile pour compiler une branche. Les
propriétés d'une branche compilée ne peuvent plus être modifiée à
l'exception des propriétés qui ont explicitement été déclarées
modifiables AVANT la compilation. Tenter de modifier une propriété non
modifiable ou de déclarer une nouvelle propriété modifiable après
compilation provoque une exception. Compilez votre graphe de
scène. Tentez de lire la matrice de transformation 3D qui positionne
le cube coloré. Ajoutez maintenant la capacité "lecture de
transformation" au groupe de transformation par l'intermédiaire de la
méthode TransformGroup.setCapability avant
compilation. Vérifiez que cela ce passe mieux.
com.sun.j3d.utils.geometry.ColorCube par votre propre
forme 3D. Une forme 3D hérite de la classe Shape3D. Une
forme 3D est définie par sa géométrie et son
apparence. Nous ne nous intéresserons qu'à la géométrie pour
l'instant: créez un objet de type QuadArray représentant
la géométrie d'un cube et ajoutez le dans votre forme 3D par
l'intermédiaire de la méthode Shape3D.setGeometry.
RotationInterpolator. Un
interpolateur transforme le temps en une grandeur physique changeante
telle qu'une matrice de rotation dans ce cas. Un interpolateur fait
appel à une représentation intermédiaire (un objet de type
Alpha) et, pour des raisons d'optimisation, à une boite
englobante: un interpolateur n'est activé que si sa boite englobante
est visible. Vous pouvez créer plusieurs objets englobants. Dans cet
exemple, un objet de type BoudingSphere conviendra. Une
objet de type Alpha définit la fonction de transformation
du temps en valeur entre 0 et 1: vitesse, répétitivité, et
éventuellement définition d'une fonction complexe de transformation.
Ce second TD consiste à créer un univers virtuel complet sans faire
appel à la classe SimpleUniverse.
com.sun.j3d.utils. Remplacez la création du
SimpleUniverse par un VirtualUniverse. Créez
un Locale et une branche de visualisation complète. Vous
devrez en particulier veiller au positionnement de l'oeil virtuel, en
vous appuyant sur votre connaissance du repère par défaut. Créez la
chaîne de visualisation complète et assurez que votre univers pas si
simple remplit la même fonction que l'univers simple du TD1.
Viewer3D intégrant une
fenêtre graphique et toute la chaîne de visualisation. Vérifiez que
vous savez afficher plusieurs vues de la même scène 3D sous différents
points de vue.
Le cube que nous avons visualisé dans les TDs précédents n'est pas réaliste: chacune de ses faces est peinte d'une couleur unique et invariante, quel que soit le point de vue de l'utilisateur et l'éclairage. Nous allons améliorer le rendu d'une scène par l'ajout de lumières, le contrôle des matériaux dont sont composés les objets et le plaquage de textures. Le but de ce TD est de réalisé le rendu d'une scène telle que:
com.sun.j3d.utils.geometry.Sphere
vous simplifie la tâche en définissant un objet héritant de
Group et générant la géométrie voulue. Vous devrez
transmettre au constructeur de Sphere un objet de type
Appearance que vous aurez créé au préalable. La sphère
s'affiche en blanc: il s'agit de la couleur par défaut et en l'absence
d'éclairage le facettes ne sont pas colorées.
Appearance est complémentaire de l'objet
Geometry pour les formes 3D: il contrôle la manière dont
doit s'afficher la géométrie spécifiée (matériaux des faces,
transparence, etc). Créez un objet de type Material que
vous associerez à l'objet d'apparence par la méthode
Appearance.setMaterial. Le matériau d'un objet est défini
comme en OpenGL par ses caractéristiques "ambiante", "émissive",
"diffuse", "spéculaire" et de brillance. Après définition du matériau
de votre sphère, elle est affichée en noir: un matériau lui est
attribuée mais elle n'est pas éclairée.
AmbientLight et en
l'ajoutant au graphe de scène en tant que fils du même noeud que votre
sphère. Une lumière ajoutée dans une branche du graphe de scène
illumine tous les objets de cette branche indépendament du noeud
auquel elle appartient. La portée d'une lumière est cependant bornée
par un objet englobant (héritant de la classe
Bounds). Ceci permet, par exemple, d'empêcher un lumière
définie à l'intérieur d'une pièce d'illuminer les objets se trouvant à
l'extérieur. Dans cet exercice, vous pouvez créer une sphère
englobante (classe BoundingSphere) et l'associer à la
lumière ambiante par la méthode
AmbientLight.setInfluencingBounds. Le rendu s'améliore:
la sphère apparaît désormait dans une couleur uniforme correspondant à
la composition de la composante ambiante du matériaux et à la couleur
de la lumière ambiente (blanche par défaut).
DirectionalLight à
votre scène. Le rendu devient réaliste.
ColoringAttributes que vous ajouterez à votre objet
de type Appearance.
TransparencyAttributes et
réalisez le rendu de la sphère en transparence.
QuadArray si vous précisez le format
TEXTURE_COORDINATE_2 à la création de l'objet.
javax.imageio.ImageIO permet de créer un objet de
type BufferedImage à partir d'un nom de fichier
image. Avec une JDK antérieure, vous pouvez utiliser le code de la
classe ImageIO ci-dessous.
ImageComponent2D (du package
javax.media.j3d) à partir de l'image chargée.
Texture2D et associez lui la
composante d'image par la méthode Texture2D.setImage.
Appearance auquel vous
assignerez votre texture par la méthode setTexture et que
vous affecterez à votre face. La face texturée doit s'afficher dans
votre scène.
class ImageIO {
public static BufferedImage read(String filename) {
java.awt.Container observer = new java.awt.Container();
Image image = Toolkit.getDefaultToolkit().createImage(filename);
observer.prepareImage(image, null);
while(true) {
int status = observer.checkImage(image, null);
if ((status & java.awt.image.ImageObserver.ERROR) != 0) {
return null;
} else if ((status & java.awt.image.ImageObserver.ALLBITS) != 0) {
break;
}
try {
Thread.sleep(100);
}
catch (InterruptedException e) {
}
}
int width = image.getWidth(observer);
int height = image.getHeight(observer);
int[] bandOffset = { 0, 1, 2, 3};
java.awt.image.WritableRaster wr =
java.awt.image.Raster.createInterleavedRaster(
java.awt.image.DataBuffer.TYPE_BYTE,
width, height, width * 4,
4, bandOffset, null);
int[] nBits = {8, 8, 8, 8};
java.awt.image.ComponentColorModel colorModel =
new java.awt.image.ComponentColorModel(
java.awt.color.ColorSpace.getInstance(
java.awt.color.ColorSpace.CS_sRGB),
nBits, true, false, Transparency.TRANSLUCENT, 0);
BufferedImage bImage = new BufferedImage(colorModel, wr, false, null);
java.awt.Graphics g = bImage.getGraphics();
g.drawImage(image, 0, 0, observer);
return bImage;
}
}
com.sun.j3d.utils.geometry.Text2D et insérez le dans votre scène pour ajouter du texte.
javax.media.j3d.Font3D) par
un appel du type: new Font3D(new Font("Helvetica", Font.PLAIN,
12), new FontExtrusion()) . Utilisez cette fonte pour créer un
objet de type Shape3D que vous insérerez dans votre scène
pour ajouter du texte en charctères "épais".
Il est temps d'autoriser l'utilisateur à naviguer à travers l'univers
virtuel. L'interpolateur utilisé depuis le TD1 permet de faire
tourner la scène sous les yeux de l'utilisateur mais celui ci n'a pas
de contrôle interactif sur le point de vue qu'il désire prendre. Les
objets d'interaction utilisent un mécanisme général de Java3D dénomé
comportement (Behavior). Un comportement décrit la
modification du graphe de scène en fonction d'un stimulis. Un stimulis
peut être de différent type (événement de l'AWT, écoulement du temps,
action de m'utilisateur, etc). Un comportement le transforme en
différentes modifications du graphe de scène (changement d'une matrice
de transformation, de la structure du graphe, etc). Un interpolateur
est ainsi un cas particulier de comportement. D'autres comportements
permettent de gérer les interactions avec l'utilisateur: navigation et
sélection.
Vous allez dans un premier temps utiliser les classes de comportement
prédéfinies pour la navigation au clavier et à la souris. Elles sont
disponibles dans les packages
com.sun.j3d.utils.behaviors.keyboard et
com.sun.j3d.utils.behaviors.mouse respectivement.
KeyNavigatorBehavior qui
contrôle le noeud de transformation de votre classe
Viewer3D. Naviguez dans la scène en 3D en utilisant les
flêches, PgUp et PgDn.
MouseRotate,
MouseTranslate et MouseZoom. Naviguez dans
la scène en 3D en utilisant les combinaisons bouton + déplacement
souris.
Après la navigation, la sélection d'objets est la seconde nécessité
pour une application interactive 3D. Des classes de haut niveau
permettant la sélection et le déplacement (translation, rotation, ou
changement d'échelle) d'objets sont disponibles dans le package
com.sun.j3d.utils.picking.behaviors.
PickRotateBehavior que
vous ajouterez à la racine de votre graphe de scène. Introduisez 2
objets graphique dans la scène et vérifiez que vous pouvez
sélectionner et faire tourner l'un ou l'autre indépendament.
La navigation à la souris telle que réalisée dans la classe
MouseRotate ne permet la rotation qu'autour de deux
axes. Il est possible de permettre à l'utilisateur des rotations
autour de trois axes de manière intuitive en simulant une
trackball. Une trackball est une boule virtuelle centrée sur la
fenêtre de visualisation et que l'utilisateur ferait tourner selon les
trois axes selon le shéma ci-dessous:
A l'intérieur de la boule virtuelle, un déplacement de la souris provoque un rotation autour de l'axe horizontal (déplacement vertical) ou de l'axe vertical (déplacement horizontal). Un déplacement de la souris à l'extérieur de la boule virtuelle provoque une rotation autour de l'axe normal au plan de visualisation.
Afin de simuler le comportement d'une trackball il faut capturer les
événements souris, déterminer s'ils correspondent à des rotations en
X, Y, ou Z, et appliquer les rotation correspondantes au noeud de
transformation de l'oeil virtuel concerné. Java3D permet de définir
des comportements dans ce but. Un nouveau comportement hérite de la
classe virtuelle javax.media.j3d.Behavior et définit les
méthodes initialization et processStimulus. Dans
ces méthodes, le comportement doit avant tout indiquer au moteur
Java3D les conditions dans lesquels il est activé (sa méthode
processStimulus est appelée) par appel à
wakeupOn. La condition d'activation est dévalidée à
chaque appel à processStimulus et doit donc être
explicitement réaffirmée avant la sortie de cette méthode.
Trackball
et insérez la dans le graphe de scène en remplacement de la classe
MouseRotate.
Au cours des séances suivantes, vous développerez un visualisateur d'images médicales 3D. Vous devrez permettre plusieurs modes de visualisation d'une image 3D et la superposition de structures anatomiques représentées par des surfaces.
Une image 3D est un tableau tridimensionnel de valeurs discrètes d'intensité appelées voxels (par extension des pixels composants les images 2D). Il n'est pas possible de visualiser la totalité du contenu d'une image 3D en une fois mais il existe différentes métodes pour apréhender ce type de données. La plus simple est d'extraire un ensemble de plans à l'intérieur du volume et d'autoriser l'utilisateur à naviguer en les changeant interactivement.
Vous utiliserez comme point de départ les classes
de visualisation suivantes qui permettent de charger une image 3D
au format INR et d'en extraire un plan orthogonal à l'axe X, Y ou Z de
l'image.
Des données d'exemple sont disponibles ici.
Le format INR est un format simple constitué d'un en-tête de
256 caractères lisible suivit des données images sans compression.
Nous travaillerons avec des images encodées sur 8 bits (chaque voxel
est représenté par un entier entre 0 et 255 définissant l'intensité de
ce voxel). Après décompression de l'archive, vous pouvez compiler
(javac *.java) puis exécuter le programme de
visualisation sur l'image fournie en exemple:
java Main brain.inr Z 60
coupe le volume par le plan de coordonnées z=60 et affiche l'image:
Dans le code qui vous est fourni, la classe MedImage permet
de lire une image et de stocker la donnée sous forme d'un tableau de valeurs
d'intensité, la classe Slicer extrait une coupe à travers le
volume et la classe Viewer réalise l'affichage d'une coupe.
BufferedImage
à partir des données contenues dans l'objet MedImage par
l'intermédiaire d'un code tel que:
// création d'un modèle de couleurs: RGB
int[] nBits = {8, 8, 8};
ComponentColorModel colorModel =
new ComponentColorModel(ColorSpace.getInstance(ColorSpace.CS_sRGB),
nBits, false, false, Transparency.OPAQUE, 0);
// création d'un raster en écriture de dimension x*y utilisant ce modèle de couleurs
WritableRaster raster = colorModel.createCompatibleWritableRaster(x, y);
// création de la buffered image utilisant ce raster pour stocker les données
BufferedImage bimg = new BufferedImage(colorModel, raster, false, null);
// data = tableau d'octets (R,G,B,R,G,B,R,G,B,R,G,B...) pour chaque pixel de l'image:
// écrire dans data les données provenant de MedImage
byte[] data = ((DataBufferByte) raster.getDataBuffer()).getData();
MedImage.vx, MedImage.vy et
MedImage.vz retournent la dimension des voxels de l'image
dans les trois directions. Utilisez cette information pour corriger
le facteur d'anisotropie dans votre image 3D.
Des structures anatomiques représentées par des surfaces peuvent être ajoutées pour enrichir la visualisation de l'image 3D:
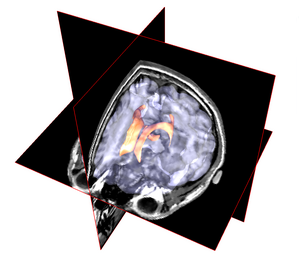
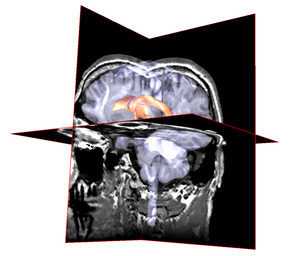
Vous trouverez dans le répertoire de données plusieurs images et maillages de structures anatomique pour l'expérimentation. Les maillages sont composés de polygônes irréguliers (nombre de côtés variables). Les fichiers maillage sont lisible en format texte. Le format de fichier est le suivant:
int # nombre de sommets int int int # position de chaque sommet ... int int int # pour chaque sommet, index de ses 3 voisins (définition ... # des arêtes) int # nombre de faces (polygônes) n i1 i2 ... in # n = nombre de sommets de chaque polygône ... # i1 i2 ... in = index des n sommets du polygône
Par exemple, le tétrahèdre représenté dans la figure ci-dessous serait encodé tel que montré à droite.
4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3 2 1 0 2 3 1 0 3 0 1 2 4 3 0 1 2 3 0 1 3 3 0 2 3 3 1 2 3 |
Par extension des textures 2D, il est possible de définir une texture 3D. Une texture 3D est un volume d'intensité qu'il est possible de couper par un plan quelconque pour en visualiser une tranche. Imaginez une texture 3D représentant du bois: elle ne contiendrait pas uniquement une image de la surface mais une information sur chaque point du matériau. Plaquer un plan de cette texture 3D reviendrait à couper le volume de bois à la scie et à en visualiser la tranche découpée.
Les images médicales 3D correspondent exactement à des textures 3D: ce sont des volumes denses donnant une information sur l'intensité de chaque point du corps. Extraire un plan de texture 3D dans une image médicale est une manière élégante de visualiser une coupe. On peut alors très simplement extraire n'importe quel plan orthogonal à l'axe des X, Y ou Z mais encore n'importe quel autre plan comme l'illuste la figure suivante:
Comme pour les textures 2D, les dimensions des textures 3D doivent être des puissances de 2. En outre, en raison de limitation de l'espace de mémoire de texture disponible, une dimension ne peut pas dépasser 128 (une fois la limite dépassée, la texture n'est pas chargée en mémoire et le plan de coupe apparaît blanc). Il faudra donc prévoir de modifier les images (troncature ou redimensionnement) pour qu'elles puissent être chargées en mémoire de texture.
Une technique alternative pour la visualisation des images 3D est le rendu volumique. Le rendu volumiqe consiste à estimer que tous les voxels de l'image sont plus ou moins translucides et que le volume est vu en transparence. On apréhende ainsi l'intégralité du volume à travers une seule image que l'on peut faire évoluer en faisant varier l'angle de visualisation.
La méthode la plus directe pour implémenter le rendu volumique consiste à réaliser un lancer de rayon (ray tracing): des rayons sont lancés depuis le point focal de l'oeil virtuel vers tous les voxels de l'image. L'absorbtion/réflexion des rayons est calculée en fonction de la transparence/opacité des voxels rencontrés. On détermine ainsi la couleur de chaque pixel de l'image. Cette méthode est cependant coûteuse en calcul.
Une méthode plus simple de mise en oeuvre et permettant l'utilisation du matériel graphique est le découpage de la scène en plan parallèles entre eux, tous orthogonaux à l'axe de visualisation comme illustrés dans la figure suivante:
Les voxels de chaque plan sont rendus plus ou moins opaques. La superposition de toutes ces couches transparentes donne un apperçu de rendu volumique. Afin d'améliorer la visualisation, il faut encore définir la fonction de transformation des intensité en transparence: on peut privilégier les régions claires en attribuant pour transparence l'intensité de chaque point (les points noirs deviennent complètement transparent et les points blancs complètement opaques). On peut encore spécifier une fonction de correspondance entre intensité et opacité permettant de contrôler les structures visibles. Ainsi, dans les images du cerveau qui vous sont fournies, rendre les intensités de l'image correspondant au crâne, à la matière grise ou à la matière blanche plus ou moins opaques permettent de visualiser ces différentes structures.